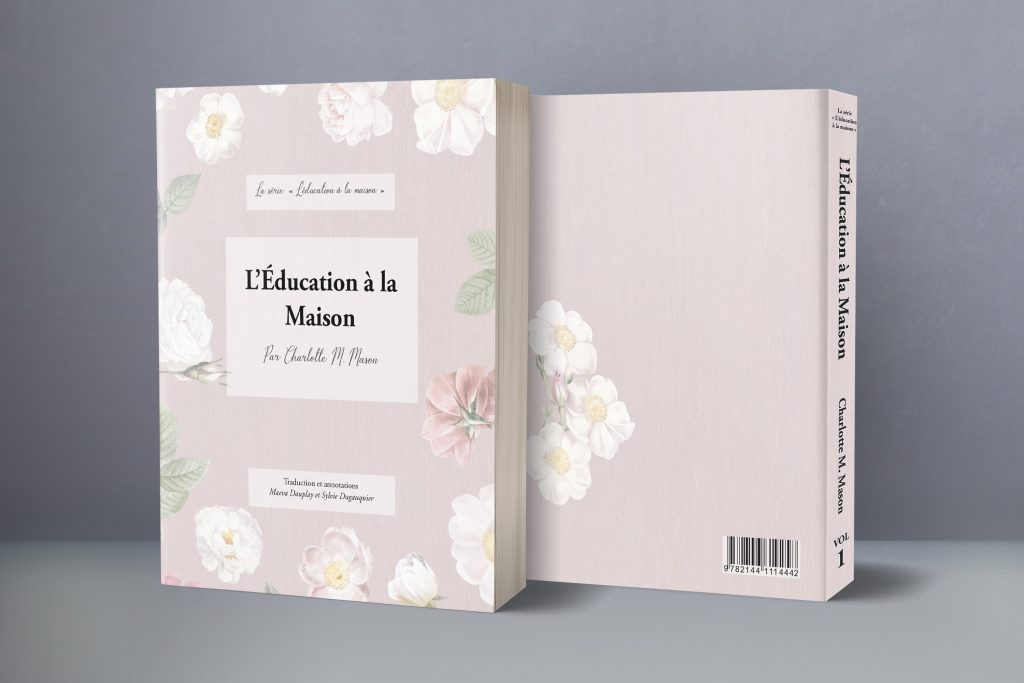Note (d’après l’article de Charlotte Mason Poetry par Dawn Rhymer) : Demander à nos enfants de raconter est une tâche trompeuse. Cela semble être une question si simple : « Dis-moi ce que tu as entendu. » Comment quelque chose d’aussi simple peut-il se terminer par des larmes, de la déception, un sentiment d’échec et même de la colère ? Au cours de mes interventions sur la narration ces quatre dernières années, ma plus grande joie a été d’assister, au moment où les parents réalisent qu’ils écrasent leurs enfants dans ce domaine, qu’ils troquent le lourd marteau contre la méthode vivifiante que Charlotte Mason a conçue pour la narration.
Le problème de la narration n’est pas seulement un défi moderne. Stanley Boardman était le directeur de la Council School de Bishop’s Cleeve, un village du Gloucestershire. En 1927, il a écrit un article pour la Parents’ Review sur la méthode et l’objectif de la narration des Parents’ Union Schools (PUS). M. Boardman avait une grande expérience de la narration puisque la Council School suivait les programmes PUS pour les Forms I à III et avait probablement des élèves âgés de 4 à 14 ans. En outre, il est probable que M. Bishop ait été encadré par H.W. Household, un pionnier de l’adoption des méthodes de Mason dans le système scolaire. M. Household était le directeur de l’éducation du Gloucestershire, et il est probable que la Council School ait été placée sous sa juridiction.
Nous avons tendance à croire que nous sommes les seuls à avoir des difficultés et que tous ceux qui nous entourent appliquent magnifiquement ces méthodes dans leurs foyers. Mais il y a presque 100 ans, M. Boardman a identifié le défi que représente la narration et a proposé aux enseignants et aux parents un garde-fou pour les aider à garder le cap. Dans son article, il donne des idées pour transformer la narration en « un processus qui fait toute la différence entre un enfant qui sait une chose et un enfant qui ne la sait pas ». Il aborde clairement notre rôle de parent ou d’enseignant, il met en lumière les dangers que nous devons éviter et nous donne un aperçu de ce qu’il faut faire lorsqu’un enfant ne veut tout simplement pas raconter.
Voir de manière aussi poignante les défis et les paroles inspirantes de ceux qui nous ont précédés nous donne beaucoup d’espoir. Puisse cet article vous encourager alors que vous cherchez à « être un guide, souvent un philosophe, et toujours l’ami » des enfants à qui vous avez le privilège et l’honneur de demander une narration.
Par Stanley Boardman
Directeur de la Council School, Bishop’s Cleeve
The Parents’ Review, 1927, p. 469-475
Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée ce matin, comme je reconnais aussi l’honneur, d’examiner avec vous cet aspect très important de notre travail, la méthode de narration P.U.S. et son but. Puis-je inverser l’ordre des choses et parler d’abord de son objectif ?
M. George Sampson, écrivant dans la presse quotidienne il y a quelque temps, un article très stimulant sur l’indigestion mentale, a dit que « rien de ce que nous apprenons n’a la moindre valeur, pour nous, jusqu’à ce que cela fasse partie de nous. Nos mémoires mécaniques pourraient bien être stockées avec énormément de matière que nous ne nous en porterions pas mieux ». Or la narration est l’acte de transformer ce que nous lisons en une partie de nous-même. La narration est la preuve d’un acte conscient, la preuve d’un effort mental conscient. C’est la preuve d’une digestion mentale. Physiologiquement, nous savons, certains d’entre nous à nos dépens, que si nous voulons nous nourrir des aliments que nous prenons, ces aliments doivent être digérés entièrement. Et dans la vie mentale, nous devons convenir que si l’on veut, comme le suggère M. Sampson, tirer une quelconque nourriture mentale de ce que l’on lit ou apprend, alors ce que l’on lit ou apprend doit être « digéré mentalement ».
Le travail de l’enseignant, je suppose, consiste à éduquer l’enfant qui lui est confié, à faire en sorte que ce qu’il apprend fasse partie de lui, à faire en sorte que les informations deviennent des connaissances. L’enseignant a apporté à cette tâche beaucoup de réflexion, beaucoup de soin et beaucoup d’énergie. Ses leçons orales ont été des modèles de ce que de telles leçons devraient être, soigneusement préparées, soigneusement planifiées et intelligemment dispensées. L’éducation est encore soumise à de nombreuses tyrannies, mais à aucune aussi grande que celle de la leçon orale – la leçon orale avec sa préparation, sa présentation, son application, sa récapitulation et ses notes complètes au tableau – la leçon orale avec tous les accessoires et supports imaginables destinés à soulager l’enfant de tout effort mental, la leçon orale où le professeur est le partenaire actif et l’enfant le partenaire passif, souvent littéralement, le partenaire dormant, dans l’entreprise de l’éducation. Nous savons qu’un enfant peut effectivement suivre une série de questions et peut, avec une certaine confiance, suggérer une série de réponses. Mais ne pensez-vous pas que le véritable effort mental, la visualisation de l’ensemble, ait été celui de l’enseignant ? L’enfant arrive sans doute au point où l’enseignant souhaite qu’il arrive, mais il n’a pas exercé ses « muscles mentaux » pour y parvenir. Il a bénéficié d’un transport en cours de route. « L’homme civilisé, dit Emerson, a construit un carrosse mais a perdu l’usage de ses pieds. Il est soutenu par des béquilles, mais il lui manque autant de soutien musculaire. » Et l’enfant étant arrivé au point désiré, dans un carrosse pour ainsi dire, et en vertu de beaucoup de travail de la part de l’enseignant, il manifeste inconsciemment sa désapprobation de la méthode en oubliant tout promptement. Ce qui devait nourrir son esprit n’a pas été digéré, l’apprentissage n’est pas devenu une partie de lui-même. Non, je pense que nous devons être d’accord avec M. Sampson, quand il suggère que nous ne sommes qu’en train de réaliser, lentement, le fait que la seule personne qui peut vraiment éduquer l’enfant est l’enfant lui-même. « Et l’enseignant ? » dites-vous. L’enseignant, dans sa juste relation avec l’enfant, est un guide, un philosophe et, je l’espère, un ami, et non une source d’informations de seconde main qui doivent être injectées dans l’esprit de l’enfant bon gré mal gré. C’est la voie du bachotage et, comme on l’a dit, le bachotage est une alimentation peu judicieuse. « Ils bachotent et ne savent pas », dit Ruskin. « Ils racontent et savent », suggère Miss Mason. Mettons l’enfant là où il peut acquérir des connaissances et la narration lui permettra de les assimiler. « L’endroit où nous allons pour obtenir des connaissances, dit Carlyle, ce sont les livres eux-mêmes. Tout repose sur ce que nous lisons, après que toutes sortes de professeurs aient fait de leur mieux pour nous. La véritable université, de nos jours, est une collection de livres. »
Tel est donc le but de la narration, un but que nous ferions bien de garder constamment à l’esprit. Il ne faut pas s’y tromper. Il ne s’agit pas d’un instrument de l’enseignant destiné à savoir si l’enfant a accompli une tâche donnée. Il ne s’agit pas d’un acte de mémoire verbale. C’est un processus qui fait toute la différence entre un enfant qui sait une chose et un autre qui ne la sait pas. La narration est, en effet, comme la foi, la substance des choses espérées, l’évidence des choses non vues. Elle est la méthode par laquelle l’enfant assimile ce qu’il lit.
Voilà, brièvement, pour le but de la narration. Puis-je aborder aussi brièvement l’application pratique du principe ? Je ne pense pas pouvoir proposer de « règles de narration ». Je ne le ferais pas si je le pouvais. Je peux seulement vous faire part de quelques réflexions qui me sont venues à l’esprit de temps en temps. Tout d’abord, je suis arrivé à la conclusion que la narration – ou devrais-je dire la narration réussie – implique une question plus large, cette question dont on parle un peu librement de nos jours comme de la liberté de l’enfant. Edmond Holmes nous dit que « tout adulte qui exige de l’enfant une foi aveugle et une obéissance littérale, et qui, après s’être assuré de cela, lui dit dans les moindres détails ce qu’il doit faire, dire, penser (ou faire semblant de penser), sentir (ou faire semblant de sentir), dévitalise toute sa personnalité. À moins que l’enfant lui-même, son âme, son moi, son ego, appelez-le comme vous voulez, ne soit derrière ses propres actions, celles-ci ne sont pas vraiment les siennes. » Je crois, avec Mlle Mason, que la narration est un art inhérent à l’enfant. Je suis sûr qu’un enfant aime raconter parce qu’il sent qu’il y a là, au moins, quelque chose qui lui appartient, parce qu’il sent que c’est lui qui est derrière tout cela. C’est un acte naturel, mais comme tous les autres actes naturels, il s’atrophie, et s’atrophie vite, dans une atmosphère non naturelle. Je crois que si l’enseignant domine l’enfant, la narration en souffrira. L’enfant aussi. Et je crois – pour reprendre les mots de Holmes – que si chaque action de l’enfant, à l’école, n’est que le résultat d’un ordre émanant d’une autorité autocratique, si les instincts de l’enfant sont réprimés par la volonté d’un autre, la narration ne sera pas, ne peut pas être, l’art spontané et délicieux qu’elle devrait être. La tentation est grande de faire une digression sur ce point, mais je dois me contenter d’évoquer, en passant, les conditions de l’atmosphère mentale de la classe. Au moins, il ne doit pas y avoir de dépressions centrées sur l’Islande – l’Islande étant représentée par le bureau du professeur.
Ayant créé l’atmosphère adéquate, il y a peut-être deux dangers contre lesquels nous devons nous prémunir en ce qui concerne la narration. Le premier est une relique du passé. Lorsque nous voyons un enfant qui avance à tâtons, qui se débat avec l’éternelle question « Et après ? », nous sentons que nous devons l’aider d’une manière ou d’une autre. Nous sentons que nous devons intercaler une question, nous sentons que nous devons le lui dire – une fois de plus, nous sommes tentés de faire le travail nous-mêmes. Il peut y avoir des occasions où un mot de temps en temps peut être utile, comme dans le cas d’un enfant qui a rencontré un nom inconnu, mais dans l’ensemble, je pense que nous ne devrions pas interférer dans la narration de l’enfant. Une discussion, ensuite, permettra probablement d’éclaircir les difficultés. La narration est le moment du travail « oral ». Le deuxième danger que je vois est celui de l’excès d’anxiété. Sachant la valeur de la narration, nous sommes très désireux que l’enfant raconte bien, et il m’est apparu que, d’une manière subtile, cette anxiété est communiquée à l’enfant. Je peux me tromper. Mais j’ai le sentiment qu’un enseignant anxieux fait un enfant anxieux et perturbé, et un enfant anxieux et perturbé n’est pas lui-même, n’est pas à l’origine de ses propres actions. J’ai dit que nous ne devions pas aider l’enfant, mais il y a peut-être une ou deux façons de le faire. En voici une. Nous pouvons aider en gardant pure et sans tache notre foi dans la capacité de l’enfant à accomplir un acte naturel.
Encore une fois, dans l’application pratique des principes de la narration, il faut veiller à faire la distinction entre ce qu’on a appelé la mémoire verbale et la mémoire de l’esprit. A plusieurs reprises, on m’a dit que nous enseignions des trucs de mémoire. Ma réponse invariable est de lire un passage assez long qu’il est impossible de mémoriser en une seule lecture, et de demander à l’enfant de le raconter. Le critique est obligé d’admettre qu’il ne s’agit pas de mémoire verbale, ni de l’ennuyeuse accumulation de détails détachés de leur contexte, ni de l’apprentissage des choses par cœur. L’apprentissage, à la manière d’un perroquet, de notes prises sous la dictée du maître ou pendant le déroulement de la leçon orale, ou même l’apprentissage de nos chers résumés au tableau noir, voilà la mémoire verbale, une méthode ancestrale qui, je crois, existe encore. La narration assure une vision de l’ensemble dans une séquence ordonnée, et c’est cette compréhension qui est la connaissance. Je reconnais que l’enfant se souvient de passages et de phrases marquants et qu’il les utilise à l’occasion, mais pourquoi ne le ferait-il pas ? Combien d’exercices ont été conçus pour suivre la lecture d’extraits littéraires, des exercices du type : « Organisez les mots suivants, dans des phrases complètes », des exercices conçus dans le but exprès d’apprendre à l’enfant à utiliser les mots et les phrases d’un auteur. De façon assez incohérente, parce qu’un enfant a utilisé, et utilise, notez bien, après une seule lecture, et non pas à la suite d’une série d’exercices inintéressants, une phrase marquante qui est apparue dans sa lecture, et on nous accuse d’enseigner des trucs de mémoire. On me demande souvent, à ce propos, combien il faut lire à un enfant, ou combien il doit lire lui-même, avant de raconter. Un certain nombre de considérations conditionnent la réponse – il y a la capacité de l’enfant, il y a l’âge de l’enfant, il y a le degré de difficulté du livre, mais dans l’ensemble, je pense qu’il faut en lire suffisamment pour qu’il soit impossible à l’enfant de s’en souvenir verbalement. En outre, je pense que la partie lue devrait, dans la mesure du possible, constituer une entité en soi, c’est-à-dire contenir un fait central, former une ou plusieurs images mentales de longueur variable selon le type de livre. Et voilà une tâche pour l’enseignant. Je suis certain de l’efficacité d’une préparation préalable de la part de l’enseignant. Il est si facile de prendre un livre, de tourner à la page voulue et de lire sans savoir ce qui va suivre ou jusqu’où on va avant de demander une narration. Non, je suis sûr qu’une préparation minutieuse est un facteur aussi important dans le succès de la narration que dans n’importe quel autre domaine de notre travail.
Je soupçonne également que si l’enseignant apprécie l’imagerie et le langage du livre, cela a un effet subtil sur la narration qui en découle. La vertu est sortie de lui. Je ne sais pas si j’ai raison ou non, mais je pense que le plaisir évident de l’enseignant dans la lecture contribue à un sentiment similaire chez l’enfant et à une facilité de narration conséquente. Je suis certain, cependant, qu’un enfant n’appréciera pas une lecture parce qu’on lui dit qu’il le devrait. De plus, et c’est là une autre façon dont je crois qu’un enseignant peut aider, je pense que la qualité de la lecture de l’enseignant a son effet : une lecture, pas monotone d’une part, et certainement pas trop soulignée d’autre part, mais une lecture clairement articulée qui permet à la puissance des mots eux-mêmes d’atteindre l’enfant.
Au fur et à mesure que l’enfant progresse dans sa scolarité, il se charge lui-même de plus en plus de la lecture. Et à juste titre, car si l’éducation est une préparation à l’avenir, et si elle doit être un processus continu, l’enfant sera finalement obligé de s’appuyer sur ses propres lectures. Comme dans le cas où le maître lui fait la lecture, s’il veut assimiler lui-même ce qu’il a lu, il doit le raconter. Mais comme les conditions de vie dans les écoles sont très diverses, la méthode adoptée sera différente d’une école à l’autre. Mais qu’il s’agisse de la narration à un chef de groupe, ou à un camarade spécial dans un coin, qu’il s’agisse de la narration au maître ou à la classe, ou qu’il s’agisse de la narration écrite ou de la narration silencieuse, il faut la pratiquer, et je ne doute pas que chaque maître élaborera sa (ou ses) propre méthode et qu’elle s’appliquera à ses conditions particulières.
Il y a cependant une méthode qui, à mon avis, pourrait avantageusement être pratiquée un peu plus avec des élèves plus âgés. Je veux parler de la narration silencieuse. La narration orale sera toujours présente et il est bon d’entendre les enfants s’exprimer avec aisance et sans gêne. Mais, plus tard dans la vie, l’enfant sera laissé à sa propre lecture et, de par la nature des choses, il n’aura pas toujours l’occasion, ni même l’envie, de raconter oralement. Par conséquent, s’il a été entraîné, à l’occasion, à la narration silencieuse, cela lui sera très bénéfique. La grande difficulté, bien sûr, est de s’assurer que l’enfant « révise » sa lecture de manière réfléchie, avec soin et dans un but précis. En effet, on me demande parfois : « Comment faites-vous pour vous assurer que vos enfants racontent lorsqu’ils sont en groupe, par exemple ? » ou « Que faites-vous avec un enfant qui ne travaille pas ? ». Là encore, c’est la tâche de l’enseignant. Là encore, l’enseignant doit être un guide, souvent un philosophe, et toujours un ami. Tout enseignant connaît l’enfant qui, pour des raisons connues ou inconnues, a ce que W.W. Jacobs – je crois que c’est lui – appelle une répugnance générale au travail. Je pense que sous une direction sage et sympathique, la grande majorité des enfants travailleront honnêtement. Je crois que les enfants ont un grand potentiel pour le bien, et c’est la tâche de l’enseignant d’utiliser ce potentiel. Si l’on fait preuve d’un bon esprit – et l’enseignement exige un bon esprit – l’enfant éprouve de la joie – qui n’en éprouve pas ? – à acquérir des connaissances. Bien sûr, nous devons être sûrs que l’enfant travaille au mieux de ses capacités, mais je crois que la patience et le tact réussiront là où la contrainte ne réussira pas. Nous ne pouvons pas permettre de fuir les difficultés, nous ne serions pas fidèles à notre devoir si nous le faisions – et aucun enseignant expérimenté n’est trompé longtemps. Si un enfant ne raconte pas, il vaut la peine d’essayer d’en découvrir la raison. Un médecin, ayant diagnostiqué un membre cassé, ne traite pas pour autant le patient pour la scarlatine. Ayant trouvé la raison pour laquelle l’enfant ne raconte pas, nous pouvons appliquer un remède approprié. La tâche de l’enseignant est difficile dans ce domaine. Un visiteur, quittant l’école il y a quelque temps, disait : « C’est très bien, les enfants semblent travailler, ils prennent leurs livres, ils racontent et, ayant fini, ils prennent un autre livre et répètent le processus. Mais vous, que faites-vous ? » Telle est la question : que fait l’enseignant ? Pour assurer un effort honnête, pour assurer une bonne narration et donc l’assimilation de ce qui est lu, il faut une activité « incessante mais tout à fait discrète » de la part de l’enseignant. Cela fait appel, comme le dit Holmes, « au tact et à la patience, à l’imagination et à l’ingéniosité, à la sympathie et à l’intelligence ». Il est beaucoup plus facile de forcer les enfants à être des récepteurs passifs de certaines bribes d’informations prédigérées, il est beaucoup plus difficile de permettre à l’enfant d’être actif en la matière et de l’amener à faire de son mieux. Cela demande une grande foi et une grande confiance – plus le cas est difficile, plus la foi et la confiance sont grandes. Et le cas le plus difficile est toujours celui de Johnny Untel dans notre propre classe.
Version française de l’article publié par Charlotte Mason Poetry avec leur autorisation. (Traduction ©2021 Sylvie Dugauquier. Relecture et révisions Charlotte Roman)