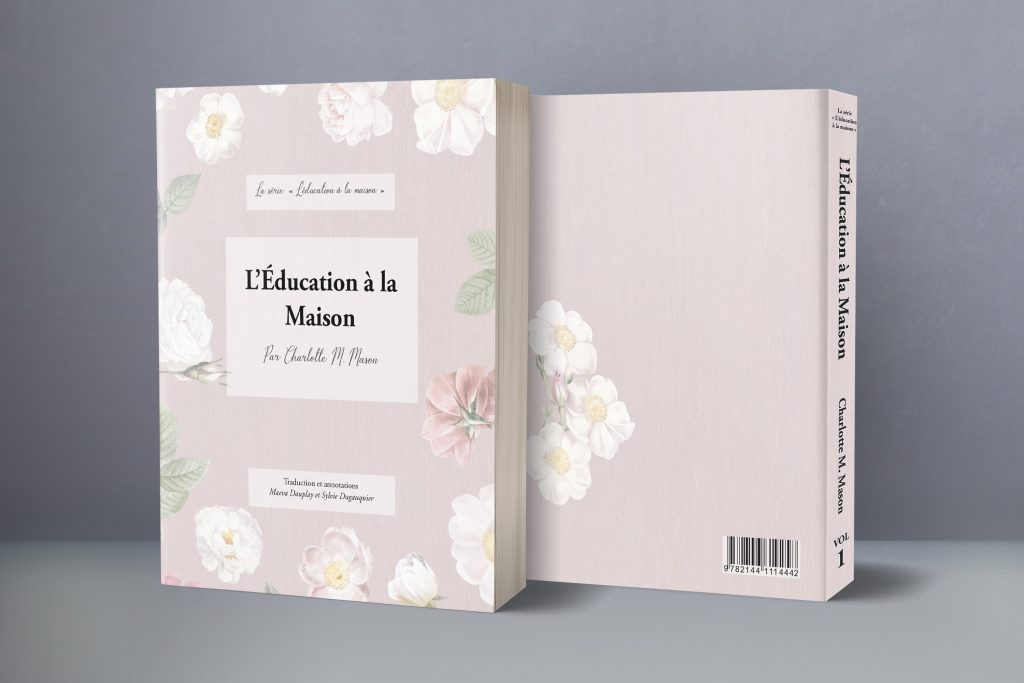Note de Charlotte Mason France : Nous avons été très heureuses d’apprendre que les mots d’Ernest Legouvé, homme de lettres français du XIXe siècle, ont conquis Charlotte Mason au point d’en faire traduire son Petit traité de lecture à haute voix pour son lectorat. Présenté en six parties, il apparaît dès le volume 1, en 1890/91, pp. 526, 618, 689 et 915 ; puis dans le volume 2, 1891/92, pp. 66 et 455.
En tête des traductions, il est écrit : « Traduit pour la « Parents’ Review » par Mrs. Swire (avec l’aimable autorisation de MM. Hetzel & Cie. de Paris).«
Ernest Legouvé est également l’auteur de « La Lecture en action » (1881) et de « La Lecture en famille » (1882).
- Chapitre 1
- Chapitre 2 – Peut-on apprendre à lire ?
- Chapitre 3 – Partie technique de l’art de la lecture. La voix.
- Chapitre 4 – La respiration
- Chapitre 5 – Prononciation
- Chapitre 6 – Zézaiement et grasseyement
- Chapitre 7 – Bégaiement
- Chapitre 8 – La ponctuation
CHAPITRE I
La lecture à haute voix compte, en Amérique, parmi les éléments les plus importants de l’instruction publique ; elle est une des bases de l’enseignement primaire.
En France, elle n’a pas même la valeur des arts qu’on appelle arts d’agrément, on la regarde comme une curiosité, comme un luxe, parfois comme une prétention.
Parcourez tous les degrés de l’instruction, vous ne la trouverez nulle part. Y a-t-il un cours de lecture, un concours de lecture, un prix de lecture à haute voix dans les écoles primaires ? Non. Dans les écoles normales primaires ? Non. Dans les écoles industrielles ou commerciales ? Non. Dans les lycées ? Non. Ni maîtres ni élèves n’apprennent à lire. Passez des maisons d’éducation dans la société, prenez l’une après l’autre toutes les professions libérales ; où se trouve cette étude ? Les avocats apprennent-ils à lire ? Non. Les magistrats ? Non. Les avoués, les greffiers, les membres des compagnies savantes ? Non. Nous avons des maîtres pour tous nos organes, pour tous nos membres, pour tous nos exercices. On nous enseigne à danser, à nager, à boxer, à sauter, à faire des armes, à courir ; seul, l’organe dont nous usons toute la journée et dans toutes les circonstances de la vie, l’instrument qui nous sert d’intermédiaire dans tous nos rapports avec les autres hommes, la voix, n’est l’objet d’aucune éducation.
D’où vient cette singulière anomalie ? De trois erreurs. On néglige ou on rejette l’étude de la lecture à haute voix
- comme inutile,
- comme encombrante,
- comme impossible.
Examinons ces trois objections au point de vue des écoles primaires.
1. UTILITÉ.
Quelques esprits prétendus graves vous disent : tout, dans l’enseignement primaire doit avoir un caractère sérieux et pratique. L’art de la lecture peut servir d’agréable complément à l’éducation des classes riches ; il peut former de beaux diseurs de salon, voire même des comédiens de société, mais à quel titre l’introduire dans le sévère et sobre programme des écoles primaires ? Ce que renferme ce programme s’appelle la grammaire, la géographie, l’arithmétique, l’histoire. Qu’ira faire, dans une si austère compagnie, cet art aimable, qui a toute la grâce mais toute la frivolité d’un amusement mondain ? A quoi servira-t-il aux fils et aux filles de fermiers, de paysans, d’ouvriers ? A quoi servira-t-il à leurs instituteurs ?
Il leur servira à mieux remplir leur rôle de maîtres et d’élèves.
Oui, certes, l’art de la lecture est un art agréable, mais c’est aussi, c’est surtout un art utile. Oui ! Il a sa place marquée dans l’éducation élégante des classes riches, mais il doit entrer dans l’enseignement des classes populaires, sinon au même rang, du moins au même titre que la géographie ou la grammaire. Il n’est pas le privilège de quelques-uns, il est le besoin de tous.
Prenons des faits pour preuves. Les fonctions de l’instituteur primaire consistent à donner des explications, à lire des morceaux détachés, à corriger des devoirs tout haut ; or, avec quoi lit-il, explique-t’il, corrige-t-il ? Avec sa voix. Y a-t-il intérêt pour l’élève à ce que cette voix soit claire et juste ? Explications orales ou morceaux lus tout haut ne s’imprimeront-ils pas plus fortement dans l’esprit de l’enfant si la prononciation est nette, si le débit est approprié aux paroles ? C’est incontestable, car les mots ne sont pas tout dans le débit ; la musique des mots, l’accent des mots ont leur valeur, ils sont à la parole ce que sont les plumes à une flèche, elles la portent plus loin et plus avant.
Ce n’est pas tout. Les classes commencent à huit heures et finissent à quatre ; soit sept heures de travail, si l’on en déduit le moment du repos. Pendant ces sept heures, que fait le maître ? Il parle. Ces sept heures de parole par jour durent dix mois par année, et cette année se prolonge pendant dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans ! Quelle fatigue ! Quel métier ! Il y a donc, pour le maître, intérêt de premier ordre, intérêt de santé, intérêt de vie peut-être, à savoir se servir de son unique et fragile instrument de travail, à le ménager, à l’économiser, à le rendre capable de fournir à une si pénible et si longue besogne. Eh bien, un des résultats de l’étude de la lecture est précisément de vous apprendre à lire et à parler sans fatigue.
Quant aux enfants, un mot suffira. Quel est leur principal travail ? Apprendre des leçons et les réciter. Quel doit être leur but ? Apprendre ces leçons le plus vite possible, les réciter le mieux possible, et les retenir le plus longtemps possible. Or, que l’art de la lecture conduise sûrement l’élève à ces trois résultats, c’est ce que va vous prouver ma réponse à la seconde objection.
2. ENCOMBREMENT
L’encombrement est un des grands malheurs de l’enseignement public actuel. Les élèves succombent sous la masse des objets d’étude. Les programmes sont apoplectiques. Les classes sont trop petites pour le nombre d’élèves qu’elles renferment. Les heures sont trop courtes pour les leçons qu’on y entasse. Le temps manque aux enseignants aussi bien qu’aux enseignés. Comment donc songer à la création d’un enseignement nouveau ? Où le mettre ? Que supprimer pour lui faire place ? La réponse est facile. L’art de la lecture n’entrera utilement dans l’instruction, qu’à la condition de ne rien encombrer, de ne rien supprimer, de ne prendre la place de rien, mais de se mêler à tout pour venir en aide à tout. Ce n’est pas une surcharge pour la mémoire, c’est un auxiliaire ; ce n’est pas une fatigue pour l’intelligence, c’est un allégement et un soutien. Elle joue dans l’instruction le rôle des adjuvants dans le phénomène de la nutrition ; elle active et facilite l’assimilation ; ce n’est pas un aliment nouveau, c’est le sel des autres aliments.
Deux exemples :
Quand l’élève a une leçon à apprendre, que fait-il en général ? Il se met à marmotter à voix basse ou à haute voix, chaque mot vingt fois de suite, mécaniquement, machinalement, jusqu’à ce qu’il se soit enfoncé la page, ligne à ligne, dans la cervelle, à peu près comme on enfonce un clou dans le bois, à force de frapper dessus avec le marteau. Eh bien, je propose aux meilleurs élèves des écoles primaires un pari, que j’ai bien souvent gagné. Leur mémoire est toute fraîche, toute souple, toute nouvelle, tandis que la mienne me sert depuis bien longtemps, et, comme telle, commence fort à s’user ; je leur offre pourtant de choisir, eux et moi, une page quelconque, et je gage que je la saurai deux fois plus vite qu’eux. Pourquoi ? Parce que j’y appliquerai les règles de la lecture, c’est-à-dire que j’apprendrai ce morceau en le lisant correctement, méthodiquement, selon les lois de la ponctuation, et en suivant le mouvement de la phrase. Lue de cette façon, cette phrase s’imprimera plus promptement dans ma mémoire, parce qu’elle se dessinera plus nettement dans mon esprit. Apprendre à lire, c’est donc apprendre à apprendre ; par conséquent, ce n’est pas du temps perdu, mais du temps gagné.
De même pour les récitations à haute voix. Pas un inspecteur qui n’ait été choqué du chantonnement mêlé d’ânonnements des élèves, de cette musique nasillarde, monotone, et toujours fausse, qui blesse le bon sens autant que l’oreille, et donne au débit comme à la physionomie des plus intelligents une apparence d’imbécillité. Ils semblent devenir tout à coup stupides dès qu’ils se mettent à réciter. Ils ont l’air de ne pas comprendre ce qu’ils disent ; ils le comprennent en effet moins bien par cela seul qu’ils le récitent mal, et ils le comprendraient évidemment mieux s’ils le récitaient bien. Or, s’ils le comprenaient mieux, ne le conserveraient-ils pas plus longtemps ? C’est encore incontestable. La fidélité du souvenir tient à l’intelligence autant qu’à la mémoire ; la mémoire reçoit l’empreinte et la garde, mais l’intelligence la burine. Apprendre à lire, c’est donc apprendre à retenir, parce que c’est apprendre à comprendre. Donc, l’étude de la lecture est du temps gagné, et non du temps perdu.
La question, on le voit, se trouve bien simplifiée, et la difficulté est résolue.
Pas de cours nouveaux, pas de maîtres nouveaux pour cette science nouvelle. Ce sont les maîtres ordinaires qui l’enseigneront aux enfants avec tout le reste.
Le seul point important est que les maîtres la sachent, que la lecture entre comme étude obligatoire dans les écoles normales primaires. Une fois les instituteurs munis des principes de l’art, fiez-vous à leur oreille même, pour les appliquer. Elle sera si blessée, si agacée, cette oreille, par les vices de diction de leurs élèves, qu’ils les reprendront par égoïsme : nous ne combattons jamais si ardemment les défauts des autres que quand ils nous sont désagréables.
Résumons-nous.
L’étude de la lecture doit porter sur tout. Il ne s’agit pas de faire bien lire aux élèves un morceau détaché ; il faut exiger d’eux, impérieusement, qu’ils ne récitent pas une page, qu’ils ne donnent pas une explication, qu’ils ne fassent pas une réponse, qu’ils ne lisent pas un devoir, sans observer les lois primitives de l’art de la lecture.
Nous voilà bien loin de ces exercices publics de récitation qui consistent, le jour de la distribution des prix, à faire monter les enfants sur une estrade, dans leurs plus beaux ajustements de fêtes, et à leur faire réciter avec des gestes appris, des accents appris, des physionomies apprises, quelque fable, ou quelque scène dialoguée. Je ne voudrais pas contrister les parents, dont ces petites cérémonies font la joie, mais je ne puis oublier les moqueries des assistants, qui, en sortant, contrefont, avec mille éclats de rire, les attitudes et les inflexions de ces pauvres enfants. On pense, en les entendant, à ces poupées anglaises qui disent, papa et maman ; on croit entendre un phonographe ; ce ne sont pas des êtres humains qui parlent, ce sont des ressorts qu’on pousse.
Laissons là ces jeux puérils où l’enfance même perd son charme, je dirais volontiers, sa dignité. Avant tout, ne faisons ni des comédiens, ni des perroquets. L’enseignement actuel du dessin nous donne, à ce sujet, une utile leçon. Le temps est passé des têtes de Romulus bien ombrées, bien estompées, agrémentées de petites hachures bien alignées, le tout s’étalant sur les murailles comme témoins du talent de dessinateur des élèves. Du talent ! Pauvres petits ! Le crayon désormais va s’appliquer à des œuvres plus sérieuses.
Ainsi de la lecture. Des récits simples, des morceaux naturels, des faits et des réflexions à la portée des enfants, voilà la matière de leurs exercices. Il ne s’agit pas de leur apprendre à danser, mais à marcher. Qu’ils ne lisent rien que ce qu’ils comprennent ou sentent parfaitement. Plus de prose que de poésie. La lecture des vers demande des qualités trop brillantes et trop spéciales. Commencer cette étude par la poésie, c’est commencer les classes par la rhétorique. Faisons-leur faire d’abord leur cours de grammaire. Apprenons- leur la correction, la justesse et surtout apprenons-leur la ponctuation. L’art de la ponctuation est, comme nous le verrons tout à l’heure, la moitié de l’art de la lecture, car ponctuer en lisant, c’est non seulement être clair, c’est se reposer. Les points et les virgules, espacés dans une longue période, ressemblent à ces petits sièges échelonnés dans la hauteur d’un escalier un peu rude, on s’y arrête pour reprendre haleine.
Voilà à quelles conditions l’étude de la lecture entrera dans l’enseignement primaire comme il doit y entrer, c’est-à-dire à titre d’art utile.
Reste la troisième objection. Un entretien, que j’eus avec un des hommes qui ont rendu le plus de services à l’instruction publique en France, me servira de réponse, et nous conduira naturellement à l’objet même de ce petit traité, les principes de l’art qui nous occupe.
CHAPITRE II
PEUT-ON APPRENDRE À LIRE ?
C’était vers 1868, au printemps. A une lieue de moi, demeurait un des hommes de qui on pouvait le mieux dire ce que Mme de Sévigné disait de Montaigne : « Quel voisin de campagne il aurait fait ! » M. Saint-Marc Girardin, c’est de lui que je parle, avait en effet, par un curieux contraste, un esprit sceptique et un cœur affectueux. Je n’ai pas connu ami plus tendre, conseiller plus sûr, partenaire de causerie plus délicieux. Liberté complète dans la conversation ! Franchise absolue ! Son bon sens avait toujours la forme du badinage, et il aimait tant la raillerie qu’elle lui plaisait même dans la bouche des autres, et même contre lui ; il est vrai qu’en fait d’épigrammes il était toujours en fonds, et si on lui en envoyait une, on était bien sûr d’en recevoir deux.
J’allai donc lui soumettre mon idée d’écrire un traité sur l’art de la lecture, et d’en faire le sujet d’une conférence au Collège de France. Après m’avoir écouté attentivement et sérieusement, il me dit : « Mon ami, vous pourrez exécuter sur ce sujet des variations brillantes, des airs de bravoure qui appelleront les applaudissements ; mais une leçon sérieuse, non. La lecture n’est pas un art. C’est l’exercice naturel d’un organe naturel. Il y a des gens qui lisent bien ; il y a des gens qui lisent mal ; mais le talent des premiers est un don, un charme, une qualité, tout, excepté un art. Cela ne s’apprend pas. L’exercice de cette qualité naturelle peut donner lieu à quelques préceptes utiles : préceptes d’hygiène, il ne faut ni trop parler ni trop lire, comme il ne faut ni trop marcher ni trop manger ; préceptes de bon sens, il ne faut pas lire trop haut ni lire trop vite ; préceptes de goût, il faut tâcher de comprendre et de faire comprendre ce qu’on lit ; mais, en dehors de ces instructions sommaires qui tiendraient en quelques lignes, il n’y a pas dans la lecture ces règles précises, claires, qui constituent un art ; l’art de la lecture se compose d’un seul article : Il faut lire comme on parle. »
J’avais grande foi dans le goût de M. Saint-Marc Girardin, et je connaissais sa rare sincérité ; mais ici j’étais convaincu, et de plus j’entendais sous ses critiques une phrase qu’il ne me disait pas et qu’il ne se disait peut-être pas à lui-même, mais qui n’en existait pas moins tout au fond de sa pensée : « En fin de compte, moi, Saint-Marc Girardin, je lis très bien et je ne l’ai jamais appris ; donc, on n’a pas besoin de l’apprendre. »
Je repris donc :
« Mon cher ami, il y a une part de vérité dans ce que vous me dites ; c’est la part qui se retrouve dans tout ce que disent les hommes du monde, spirituels et instruits, sur un sujet qu’ils n’ont pas étudié. Or, tout professeur de Sorbonne que vous êtes, vous n’êtes là-dessus qu’un homme du monde ; vous parlez spirituellement de ce que vous ne connaissez pas. »
Ce mot inaccoutumé pour lui le fit un peu regimber.
Je repris avec calme : « Qu’il y ait dans le talent de la lecture beaucoup de don, c’est incontestable. Il n’en est pas de cet art comme des autres arts ou métiers, qui vous sont absolument fermés si l’apprentissage ne vous en a pas ouvert l’accès. Certains hommes lisent, sans étude, avec grâce et avec agrément ; vous en êtes une preuve, car vous lisez à l’effet, vous êtes applaudi quand vous lisez, mais vous ne lisez pas… pardonnez-moi ma franchise… vous ne lisez pas bien. »
A ce mot, il se mit à sourire d’un air narquois .
« Comment ! Je ne lis pas bien ?
– Non ! La preuve, c’est que quelqu’un qui lirait comme vous lirait mal.
– Expliquez-moi donc cela, reprit-il en riant.
– Rien de plus facile. Je vous ai entendu lire à la Sorbonne, dans votre cours, des fragments de Lamartine, de Corneille, de Victor Hugo, et je vous ai entendu lire à l’Académie des discours de vous. La différence était fort grande.
– En quoi ? reprit-il assez intrigué.
– Le voici : Les vers de nos grands poètes, lus par vous, étaient fort applaudis. Pourquoi ? Parce que vous mettiez dans cette lecture votre intelligence, votre supériorité d’esprit ; parce que vous avez une voix vibrante et un air de conviction, toutes qualités personnelles qui dissimulaient vos défauts.
– Eh ! Quels sont donc mes défauts ? S’il vous plaît.
– Votre voix a des sons un peu blessants à force d’éclat. Votre débit est parfois un peu déclamatoire ou emphatique, et l’emphase ne déplaît pas à la jeunesse… Mais changez d’auditoire et donnez votre manière à quelqu’un qui n’aura ni votre supériorité ni votre autorité, à qui il ne restera que votre manière, et il ne plaira pas, par cela seul qu’il vous aura trop bien imité ; or, il n’y a de bon que ce qui peut être imité sans danger. Donc, vous lisez avec talent, mais vous ne lisez pas comme quelqu’un qui sait lire.
– Même mes discours ?
– Oh ! Vos discours ! Personne ne pourrait les lire aussi bien que vous.
– Pourquoi ? Est-ce que là aussi mes défauts ? …
– Là, vos défauts sont des qualités, parce qu’ils font partie de votre personnalité. Un exemple vous expliquera ma pensée. Jules Sandeau avait écrit un charmant discours en réponse à Camille Doucet. II me pria de le lire pour lui en public. « Je m’en garderai bien, lui répondis-je.
– Pourquoi ? Vous le lirez mieux que moi.
– Oui ! Mais je ne le lirai pas si bien. Votre discours, c’est vous. Je ne ferai certes pas en le lisant les fautes que vous faites, je ne laisserai pas tomber mes finales, je mettrai mieux en relief les mots spirituels, mais je n’aurai pas cette nonchalance d’attitude, cette indolence de voix, cet air de ne pas y toucher, cet abandon indifférent qui compléteront vos paroles par votre personne et qui seront charmants chez vous parce qu’ils sont naturels, mais qui seraient déplaisants chez moi parce qu’ils seraient cherchés… Votre discours est un discours blond et fleuri d’embonpoint ; je le lirai comme un homme brun et maigre ; lisez-le vous-même ! »
Il me crut, et le succès lui montra combien j’avais eu raison. Mais, s’il avait lu ainsi le discours d’un autre, c’eût été une trahison !
« L’histoire est jolie, me dit M. Saint-Marc Girardin, mais je ne vois pas où elle nous mène. Je comprends ce que vous me dites, mais je ne comprends pas quelles conséquences vous en tirez.
– Un autre exemple vous le fera mieux saisir…
M. Viennet avait une grande réputation de lecteur, réputation méritée, quand il lisait ses vers. Sa voix rauque, ses gestes bourrus et imitant la franchise, sa petite mèche de cheveux en l’air comme une crête de coq, ses intonations joviales, étaient la représentation exacte de son genre de talent, avec tout ce qu’il avait de vif et d’un peu vulgaire ; ajoutez qu’il avait un goût extrême pour tout ce qu’il faisait ; il se plaisait singulièrement à lui-même, ce qui donnait à son débit, quand il lisait ses propres vers, un feu, une chaleur qui gagnait l’auditoire. On me proposa un jour de lire à l’Académie des vers de M. Viennet, je refusai, « Ni moi, ni le morceau, nous n’aurions aucun succès, répondis-je. Je manquerais absolument de ce qui fait une partie de l’effet de M. Viennet, la conviction profonde que ce que je lis est un chef-d’œuvre ! »
Cette petite épigramme, fort inoffensive, fit rire M. Saint-Marc Girardin et il ajouta gaiement :
– La conclusion ! La conclusion ! Que concluez-vous de tout cela ?
– Je conclus qu’il ne faut pas dire d’un écrivain qu’il lit bien, parce qu’il est applaudi en lisant ce qu’il a fait, attendu que, parfois, ses défauts de lecteur sont pour quelque chose dans son succès ; c’est un homme ajouté à un discours. J’en conclus qu’il faut laisser de côté certaines natures d’élite, certaines organisations exceptionnelles comme la vôtre, qui peuvent se passer de règles, tant elles ont bonne grâce à sauter par dessus ! « L’art n’est pas fait pour toi ; tu n’en as pas besoin. » Mais je conclus aussi que les hommes ordinaires, la masse, la majorité, le vulgaire, a besoin d’apprendre à lire, et que cette science, qui serait utile même aux êtres supérieurs, car, enfin, mon cher ami, vous auriez un peu plus de science que vous n’en auriez pas moins de talent, est indispensable à tous les autres.
– Mais, enfin, cette science, en quoi consiste-t-elle ? Comment se définit-elle ?
– L’art de parler et de lire correctement.
– La correction suppose des règles. Quelles sont ces règles ?
– Elles sont de deux sortes, matérielles et intellectuelles ; car l’art de la lecture repose à la fois sur l’exercice d’un organe physique, la voix, et sur un organe spirituel, la pensée…. Voulez-vous que nous étudions d’abord la voix ?
– Très volontiers ! répondit M. Saint-Marc Girardin.
– Eh bien, je rédigerai mes observations par écrit, car ici il faut de la précision, et je vous les apporterai. »
Mais, hélas ! La guerre éclata ; je ne rédigeai rien, je ne lui apportai rien, et c’est seulement il y a trois mois, que, sur la demande d’un des hommes qui honorent le plus l’enseignement public, M. Bersot, je fis, pour les élèves de l’École normale supérieure, ce résumé de mes expériences.
CHAPITRE III
PARTIE TECHNIQUE DE L’ART DE LA LECTURE. LA VOIX.
La partie technique de l’art de la lecture porte sur deux objets : la voix et la prononciation ; les sons et les mots.
L’organe de la voix est semblable en apparence à l’organe de la vue et de l’ouïe, mais il en diffère en un point essentiel : c’est que les opérations de la vue et de l’ouïe sont le résultat d’un acte involontaire. Dès que vos yeux sont ouverts et qu’il fait jour, dès que vos oreilles sont ouvertes et qu’il y a bruit, vous entendez et vous voyez malgré vous. L’organe de la voix, au contraire, ne s’exerce que sous l’action de la volonté ; l’homme ne parle que quand il le veut.
Seconde différence. Vous ne pouvez pas voir plus ou moins, selon votre désir, vous ne pouvez pas entendre plus ou moins, si ce n’est quand vous vous soustrayez partiellement à l’action des choses extérieures, en mettant un obstacle, un voile, entre le monde du dehors et vous.
Il n’en est pas de même de la voix : vous pouvez parler plus ou moins fort, plus ou moins vite, vous réglez la mesure des opérations de la voix comme ses opérations mêmes.
De là cette conséquence naturelle, qu’on ne peut pas apprendre à voir ou à entendre (je parle de l’opération matérielle), et que, par conséquent, il n’y a pas un art pour la vue et pour l’ouïe, tandis qu’on peut apprendre à parler, puisque la parole est susceptible de modifications résultant de la volonté.
Un mot explique cette différence.
L’organe de la voix n’est pas seulement un organe, c’est un instrument, un instrument comme le piano. Or, qu’est-ce qui caractérise un piano ? Son clavier. De quoi se compose ce clavier ? De plusieurs octaves (six ou six et demie). Ces six octaves se partagent en trois espèces de notes : les notes basses, les notes du milieu, les notes hautes ; enfin, le son de ces notes correspond à des cordes d’une certaine grosseur. Eh bien, la voix a un clavier comme le piano ; elle a deux octaves, comme le piano en a six, trois espèces de notes comme le piano, des cordes plus minces et des cordes plus grosses comme le piano, et de même qu’on n’arrive pas à jouer du piano sans l’étudier, de même on n’arrive pas à bien jouer de la voix sans l’apprendre.
Je dirai plus. Sortant des mains d’un bon facteur, un piano est un instrument complet, parfait, et le son qui s’en échappe est aussi harmonieux que juste dès qu’un artiste le touche. Mais le petit piano que nous recevons des mains de la nature est presque toujours bien loin de cette perfection. Il y a des cordes qui manquent, des touches qui crient, des notes qui sont fausses, de façon qu’avant d’arriver à être pianiste, on doit se faire facteur et accordeur, c’est-à-dire compléter, égaliser, accorder son instrument.
Nos trois espèces de voix, qui se définissent d’elles mêmes : la voix basse, la voix de médium et la voix haute, sont toutes trois indispensables dans l’art de la lecture ; mais l’usage en doit être et en est différent, car leur force est très différente. La plus solide, la plus souple, la plus naturelle de ces trois voix, est le médium. Le célèbre acteur Molé disait : « Sans le médium pas de postérité. » En effet, le médium, étant la voix ordinaire, c’est de lui que part l’expression de tous les sentiments les plus naturels et les plus vrais ; les notes basses ont souvent une grande puissance, les notes hautes un grand éclat, mais il ne faut s’en servir qu’à propos, je dirais presque exceptionnellement : je comparerais volontiers les notes hautes à la cavalerie dans une armée, elle est réservée aux attaques brillantes, aux charges à fanfares ; comme les notes basses, semblables à l’artillerie, ont pour objet les coups de force : mais le vrai fond d’une armée, l’élément sur lequel le tacticien compte le plus et qu’il emploie toujours, c’est l’infanterie. Eh bien, l’infanterie, c’est le médium ! Le premier précepte de l’art de la lecture est donc la suprématie accordée au médium. Les cordes hautes sont beaucoup plus fragiles, plus délicates. Si vous vous en servez trop, si vous jouez trop sur ces notes-là, elles s’useront, se désaccorderont, deviendront criardes, votre petit piano se faussera, et votre organe lui-même, votre organe tout entier s’altérera. Parfois même cet abus des notes hautes influe jusque sur la pensée de l’orateur. M. Berryer m’a raconté avoir un jour perdu un très bon procès, parce qu’il avait commencé son plaidoyer sur un ton trop haut, sans s’en apercevoir. La fatigue du larynx passa bientôt aux tempes ; des tempes, elle gagna le cerveau ; l’intelligence se tendit parce que l’organe était trop tendu, la pensée s’embrouilla, et Berryer perdit une partie de ses facultés intellectuelles, parce qu’il n’avait pas pensé à descendre de ce perchoir où sa voix avait grimpé en débutant.
L’abus des notes basses, et même graves, n’est pas moins fâcheux. Il amène la monotonie, il produit quelque chose de terne, de sourd, de lourd. Talma, jeune, était porté à ce défaut. Sa voix, puissante et émue, était un peu sombre, et c’est à force d’art qu’il est parvenu à la faire sortir de la caverne où elle descendait naturellement. Un fait assez curieux me revient à ce sujet en mémoire. Mon père était un très habile lecteur. Une partie de son succès au Collège de France, où il professait, tenait à ce talent ; il intercalait dans ses leçons des fragments de nos grands poètes, et les récitait aux applaudissements universels. Ces applaudissements, auxquels naturellement il était sensible, lui attiraient des envieux, des ennemis ; un critique écrivit un jour dans un article : « M. Legouvé a lu hier deux scènes de Racine, avec sa voix sépulcrale. L’article tomba sous les yeux d’un de ses amis, M. Parseval-Grandmaison. Aussitôt, en bon camarade, il se dit : « Legouvé doit être très contrarié de cette critique, je vais aller le voir… » Il arrive ; mon père était en effet étendu sur son canapé, d’un air assez mélancolique. « Ah ! C’est vous, mon cher Parseval.
– Oui ! Est- ce que vous êtes malade, Legouvé ? Vous avez l’air sombre !
– Moi ! Non , je n’ai rien ! Un peu de mal de gorge. Dites-moi, mon cher Parseval, comment trouvez-vous ma voix ?
– Je la trouve fort belle, mon ami.
– Oui, oui ! Mais quel caractère lui trouvez-vous ? Est-ce le caractère… d’une voix… brillante ?
– Oh ! Non ! Brillante n’est pas le mot qui définit votre voix ! Je dirais plutôt qu’elle est sonore.
– N’est- ce pas ? Elle est sonore ?
– Sans doute ! Pourtant, ce n’est pas encore le nom qui lui convient le mieux ! C’est plutôt une voix grave.
– Grave ! Soit ! Mais pas sombre !
– Oh ! Non ! Non ! Pas sombre ! Pourtant il y a bien quelque chose…
– Mais enfin, elle n’est pas caverneuse !…
– Non ! Non ! Pourtant…
– Oh ! Je vois bien, s’écria mon père en riant, que vous partagez l’avis de cet abominable critique, et que vous la trouvez sépulcrale ! »
La morale de cette petite anecdote, c’est que mon père, à partir de ce jour, s’étudia à faire moins souvent usage des notes basses, à les mêler plus habilement aux deux autres registres, et arriva ainsi à cette variété de timbres qui est à la fois un charine pour l’auditeur et un repos pour le lecteur.
Ce mélange ne constitue pas le seul exercice de la voix ; il faut encore, il faut avant tout la travailler en elle-même. Le travail fortifie les voix faibles, assouplit les voix dures, adoucit les voix criardes, agit enfin sur la voix parlée comme l’art du chant sur la voix chantée. On dit quelquefois que des artistes célèbres, M. Duprez, par exemple, se sont fait une voix. Le mot n’est pas juste : on ne se fait pas une voix quand on n’en a pas, et, la preuve, c’est qu’on la perd ; on ne la perdrait jamais, si l’on était maître de se la faire ; mais on la métamorphose : on lui donne du corps, de l’éclat, de la grâce, non-seulement par la gymnastique qui fortifie l’organe en général, mais par une certaine manière d’attaquer le son. Enfin, l’étude arrive même à vous faire gagner des notes que vous n’aviez pas. Un jour, une fameuse cantatrice, Mme Malibran, chantant le rondeau de la Somnambule, termina son point d’orgue par un trille sur le ré suraigu, après être partie du ré d’en bas. Elle avait embrassé trois octaves dans sa vocalise. Avait-elle donc reçu de la nature ces trois octaves ? Non. Elle en avait acquis une partie par le travail. Je me rappelle même qu’après le concert, un de nous lui ayant exprimé son admiration de ce ré suraigu : « Oh ! Je l’ai assez cherché ! reprit- elle gaiement. Voilà un mois que je cours après lui ! Je le poursuivais partout ! En me coiffant ! En m’habillant ! Et je l’ai trouvé un matin au fond de mes souliers, en me chaussant ! » On voit que l’art, non seulement nous aide à bien gouverner notre royaume, mais à l’étendre.
CHAPITRE IV
LA RESPIRATION
Le second objet de la lecture, c’est de vous apprendre à respirer. Il semble que s’il y a un acte naturel au monde, et où l’art n’ait rien à faire, c’est l’acte de la respiration. Respirer, c’est vivre, et nous respirons inconsciemment, comme nous vivons. Pourtant, on ne lit bien que si l’on respire bien, et l’on ne respire bien que si on l’a appris. C’est même là un des talents les plus rares chez un lecteur. Je m’explique. Quand vous respirez dans la vie ordinaire, l’air entre dans vos poumons et en sort à la façon d’un flot de source qui coule continûment, insensiblement, également. Mais ce tranquille passage de l’air sur votre gosier suffirait-il pour faire vibrer vos cordes vocales ? Non ! elles resteraient muettes comme un piano que les doigts ne frappent pas. L’air est à l’appareil vocal ce que les doigts sont au piano ; il faut que l’air le touche fortement pour qu’il résonne. Peut-être quelques-uns de vous ont-ils entendu une harpe éolienne. Comment la fait-on vibrer ? On la place dans une embrasure de porte… S’il n’y a que de l’air, elle se tait ; dès que l’air se condense et devient du vent, les cordes résonnent. Eh bien, le même phénomène se produit quand vous parlez. Vous condensez, vous pressez l’air que renferment vos poumons, vous le poussez sur votre gosier, et c’est sous l’empire de ce choc que la parole se produit ! Mais qu’avez-vous fait alors ? Vous avez dépensé beaucoup plus d’air que vous ne le faites par le seul acte de la respiration ordinaire. La comparaison d’une source qui coule sans effort n’est plus juste ; il faut penser à l’eau qui jaillit sous le coup d’une pompe, et qui jaillit plus pressée, plus dense, plus rapide ! Voilà donc les conditions ordinaires de la respiration changée. On ne peut donner que ce qu’on a. Dépenser plus, c’est posséder plus. Le petit magasin d’air qui est destiné à la respiration normale et insensible, ne va plus suffire à la quantité de souffle que demande l’action énergique de la parole ; il va donc falloir établir un équilibre entre notre doit et avoir ! Il va falloir aller aux provisions, faire un appel vigoureux à la source même, c’est-à-dire à l’atmosphère, pour qu’il nous donne l’air dont nous avons besoin ; cet appel, c’est l’aspiration. La respiration se compose donc de deux actes : aspirer et respirer. Aspirer c’est acquérir, c’est emmagasiner ; respirer, c’est dépenser, c’est écouler ses marchandises.
Eh bien, il y a là deux arts différents : aspirer est un art, respirer est un art. En quoi consiste l’art de l’aspiration ? A la prendre de la base du poumon même, du diaphragme. Si vous n’aspirez que de la partie supérieure du poumon, vous faites une trop petite provision d’air. Vous ne remplissez pas votre magasin. Il n’en a guère que jusqu’au tiers. Qu’arrive-t-il ? Que votre stock s’épuise très vite, trop vite, et si vous avez un long morceau à lire, vous ressemblez à un homme parti en voyage dans le désert avec une outre d’eau à moitié pleine ; l’air vous manque ; il faut retourner en chercher, ce qui est une fatigue ; une fatigue pour vous et une fatigue pour les autres, comme vous le verrez tout à l’heure. Le premier devoir du lecteur, qui a une longue course à fournir, est donc, au début, d’aspirer profondément, de façon à avoir les poumons bien garnis. Puis arrive alors le second acte, qui est le plus difficile, dépenser. Un mauvais lecteur n’aspire pas assez et respire trop, c’est-à-dire qu’il dépense son bien sans ordre et sans mesure ; il jette l’air par les fenêtres comme un prodigue jette l’argent, il le dépense en inutilités au lieu de le distribuer avec ménagement, avec science ; en un mot, il ne sait pas le répandre largement dans les grandes occasions, et le ménager dans les petites. Qu’arrive-t-il alors ? Ce que vous voyez tous les jours ! C’est que le lecteur et l’orateur, comme certains acteurs ou chanteurs, sont obligés à tout moment de recourir à la pompe, de donner des coups d’aspiration bruyants, rauques, qu’on appelle des hoquets ; celui qui écoute en souffre autant que celui qui parle. Un chanteur très habile avait ce défaut, il prenait haleine à tout moment, et ce bruit de soufflet de forge mêlé au chant était insupportable ; il s’en est aperçu et corrigé, ce qui prouve qu’on peut s’en corriger. M. Stockhausen, un artiste supérieur, qui a quitté Paris, émerveillait tous les guides en Suisse, parce qu’il ne s’essoufflait jamais dans les plus rudes montées. « Mon secret est bien simple, me disait-il, je sais aspirer et respirer… ». Le grand chanteur Rubini avait atteint le comble de l’art. On ne l’entendait jamais respirer. Comment y arrivait-il ? une anecdote relative à Talma va nous l’expliquer.
Talma, encore jeune, jouait le Père de famille de Diderot. Arrivé à la fameuse tirade : « 1,500 livres de rente, et ma Sophie ! » il part, il s’emporte, il crie et rentre dans la coulisse, épuisé, hors d’haleine, et s’appuie contre un décor en soufflant comme un bœuf.
« Imbécile ! dit Molé, en le regardant, et il veut jouer la tragédie ! Viens me voir demain matin et je t’apprendrai comment on peut être passionné sans s’époumoner. »
Talma y alla ; mais, soit que le maître manquât de patience, ou l’élève de docilité, la leçon ne lui profita qu’à demi. Il y avait alors au théâtre un acteur nommé Dorival : maigre, malingre, sans puissance de voix, il jouait pourtant la tragédie avec un certain succès.
« Comment cet animal-là peut-il faire ? se disait Talma. Je suis dix fois plus fort que lui, et il se fatigue dix fois moins que moi. Je vais lui demander son secret. » Dorival éconduit le solliciteur par cette réponse aigre douce et qui sentait son envieux :
« Vous avez tant de succès, monsieur Talma, vous n’avez pas besoin de leçons.
– Je te forcerai bien à m’en donner, » se dit tout bas Talma.
Un jour donc que Dorival jouait Châtillon dans Zaïre, le jeune homme va se blottir… devinez où ? dans le trou du souffleur ! de façon à voir et à entendre sans être vu. Puis, une fois tapi là dans l’obscurité comme une bête de proie dans son antre, il guette, il épie, il note, il regarde, il écoute, et, après la fameuse tirade du second acte, il sort en s’écriant : « Je le tiens, je l’ai pincé ! » Qu’avait-il donc découvert ? Que tout l’art de Dorival consistait dans son talent pour respirer. En quoi consistait ce talent ? A prendre (je copie une note de Talma lui même), à prendre ses aspirations avant que l’air fût entièrement expiré de sa poitrine ; et, afin de dérober au public ces aspirations répétées, qui auraient coupé le discours et interrompu le courant même de l’émotion, il les plaçait particulièrement devant l’a et devant l’e ou l’o, c’est-à-dire aux endroits où la bouche déjà ouverte permet d’aspirer légèrement sans que l’auditeur s’en aperçoive.
On voit quel rôle immense joue la respiration dans l’art de la diction. Ses règles sont les seules qu’il ne soit jamais permis de violer. L’acteur lancé dans un passage véhément, emporté par la passion, par la colère, par la douleur, peut oublier les lois de la ponctuation, culbuter les points et les virgules, et courir à travers la phrase au gré de son désordre, mais il doit toujours être maître de son souffle, même quand il a l’air de le perdre ; un habile acteur n’a le droit d’être essoufflé que par un effet de l’art.
Talma avait réduit toutes ces règles en une maxime frappante. Tout artiste qui se fatigue est un artiste médiocre.
J’entends d’ici l’objection : cet art est peut-être fort utile pour les acteurs, mais il s’agit de lecture et non de théâtre. Eh bien, le lecteur en a plus besoin encore que l’acteur. En effet, l’acteur, si long et si important que soit son rôle, a des temps de suspension forcés ; il se repose quand les autres parlent, et ses gestes eux-mêmes, s’ajoutant à ses paroles, l’aident à leur donner un accent vrai et pénétrant. Mais le lecteur lit souvent sans s’arrêter pendant une heure entière, et l’immobilité de son corps le contraint de tirer toute sa force de sa voix seule. Jugez donc s’il est inutile pour lui de savoir ménager ce trésor du souffle, qui peut seul le conduire sans fatigue au bout de sa carrière.
Voici du reste un curieux exemple de la science de l’économie, appliquée à la respiration. Prenez une chandelle allumée, placez-vous près d’elle, en face d’elle, et prononcez en chantant la voyelle a ; la lumière vacillera à peine ; mais, au lieu d’un seul son, faites une gamme, et vous verrez à chaque note la lumière trembler. Eh bien, le chanteur Delle Sedie exécute devant une bougie allumée une gamme montante et une gamme descendante sans que la flamme s’agite. Comment ? Parce qu’il ne laisse échapper que juste ce qu’il faut de souffle pour pousser le son dehors, et que l’air, étant ainsi employé tout entier dans l’émission de la note, perd sa faculté de vent pour se réduire à sa faculté de bruit. Vous, au contraire, vous ou moi, bien entendu, que faisons-nous ? Nous perdons inutilement du vent, nous jetons du son à droite et à gauche, nous dissipons notre bien. En pressant un peu cette règle de diction, on en tirerait une leçon de morale : ne dépensez dans chaque acte de votre vie que la quantité de force intime qu’il vaut. Tous les mouvements de l’âme sont des trésors ! Économisons-les pour les circonstances qui en valent la peine. Que de gens perdent en petites impatiences, en emportements puérils, ce trésor de la colère, qui est si sacré quand elle s’appelle l’indignation !
Dernières observations, indispensables pour le lecteur. Si vous voulez aspirer et respirer librement, asseyez- vous sur un siège haut. Enfoncé dans un fauteuil, vous ne pouvez pas aspirer de la base du poumon. Je vous dirai même : ayez soin de rester bien droit. L’homme courbé aspire mal et respire mal. Enfin, tant que vous le pourrez, ayez le dos appuyé. Il m’est arrivé plus d’une fois, quand je lisais en public et que je sentais un commencement de fatigue vocale et cérébrale, de me calmer et de me reposer rien qu’en m’appuyant largement sur le dos de ma chaise. A l’instant l’équilibre se rétablissait, mon aspiration se faisait sans effort et ma tête elle-même se dégageait.
CHAPITRE V
PRONONCIATION
Nous passons du monde des sons dans le monde des mots. Nous étions restés dans les voyelles, nous allons leur adjoindre les consonnes. Les consonnes représentent la charpente du mot ; elles seules lui donnent un corps : on peut reconstituer un mot dont il ne reste que les consonnes, comme Cuvier reconstituait un être dont il ne retrouvait que les os. L’assemblage des voyelles et des consonnes constitue la prononciation, car on ne peut pas prononcer une consonne sans l’unir à une voyelle, et la voyelle à elle seule forme un son qu’on émet, mais non un mot qu’on prononce. De la bonne prononciation dépend la clarté du discours, la correction du débit, la vie même de la parole ; il est donc important d’en connaître les règles précises. Ces règles, quand il s’agit des voyelles, se réduisent à une seule ; il faut donner aux voyelles l’intonation acceptée par Paris. Paris donne la loi en fait de voyelles. Presque toutes les provinces, surtout les provinces méridionales, ont, en prononçant les voyelles, un accent qui prête quelque peu au ridicule. Je puis vous en citer un exemple frappant. Il y a quelque temps, un de nos orateurs les plus puissants parlait contre un ministre, et jamais, peut-être, ses rares qualités de verve et de feu ne s’étaient montrées plus fortes ; tout à coup, au milieu d’une phrase, lui échappe ce mot : la Chambre hotte (haute), puis viennent les fantommes (fantômes), et enfin les ennées (années). Tout le monde se mit à rire, le fil du discours fut un moment rompu, et l’effet quelque peu amoindri. Mais supposez, au lieu d’un orateur de premier ordre, un orateur médiocre, un inconnu, aux défauts duquel l’auditoire n’eût pas été habitué : les chuchotements, les ricanements l’auraient arrêté à chaque apparition de la fatale voyelle ; on n’aurait pas entendu ses paroles, on n’aurait entendu que son accent, il aurait eu grande peine à conquérir l’attention, et tout l’effort de son talent eût été perdu.
Il y a quelques jours, un jeune homme de province, plein de chaleur et de feu, me pria de lui donner quelques conseils pour lire en public. « Récitez-moi une fable de la Fontaine, » lui dis-je.
Il commença :
Du pâlais d’un jeune lâpin…
Je l’arrêtai court.
« Apprenez d’abord le son véritable des a, et nous verrons ensuite. »
Eh bien, vous trouverez partout, excepté à Paris, cette altération endémique et épidémique des voyelles. C’est tantôt l’e, tantôt l’o, tantôt l’u, qui sont défigurés ; à Paris même, les personnes d’une classe inférieure ou d’une éducation peu relevée donnent souvent aux diphtongues un son vulgaire ; combien de gens prononcent chaquin au lieu de chacun ! Exercez-vous donc, si vous voulez lire en public, à placer sur chaque voyelle l’accent qui lui convient ; songez qu’une brève, mise au lieu d’une longue, qu’un accent circonflexe substitué à un accent aigu, suffisent pour gâter la meilleure phrase.
S’il s’agit des consonnes, la science de la prononciation est la science de l’articulation. Il n’en est pas de plus difficile et de plus utile. Peu de personnes naissent avec une articulation complètement bonne. Chez les uns elle est dure, chez les autres elle est molle, chez ceux-là elle est sourde. Le travail, un travail assidu et méthodique, peut corriger ces défauts et le peut seul. Par quel moyen ? En voici un fort ingénieux, que tout le monde peut mettre en pratique, et qui est le résultat d’une observation. Vous avez un secret important à confier à un ami, mais vous craignez d’être entendu, la porte de la chambre où vous êtes se trouvant ouverte et quelqu’un étant dans la pièce voisine. Vous approcherez-vous de votre ami et lui parlerez-vous à l’oreille ? Non. Vous ne l’osez pas, de peur d’être surpris dans cette position qui vous trahirait. Qu’allez-vous donc faire ? Le voici ; je cite les paroles textuelles du maître des maîtres, de M. Régnier : vous vous mettez en face de votre ami, et là, en employant le moins de son possible, et en parlant tout bas, vous chargez l’articulation de porter vos paroles à ses yeux en même temps qu’à son oreille, car il vous regarde parler autant qu’il vous écoute parler ; l’articulation a alors double besogne ; elle fait l’office du son lui-même, et, par conséquent, elle est forcée de dessiner nettement les mots et d’appuyer fortement sur chaque syllabe pour la faire entrer dans l’esprit de votre auditeur. Voilà le moyen infaillible de corriger toutes les défaillances et toutes les duretés de l’articulation. Soumettez-vous pendant quelques mois à cet exercice, et une pareille gymnastique aura si bien assoupli et fortifié vos muscles articulateurs qu’ils répondront par leur élasticité à tous les mouvements de la pensée et à toutes les difficultés de la diction (1).
Note (1) : du reste, la méthode de M. Régnier est celle qu’on emploie pour apprendre à parler aux sourds-muets. Le maître dessine pour ainsi dire les mots devant eux avec la bouche ; pas de son ! pas de voix ! rien que l’articulation ; le sourd lit sur les lèvres.
Le rôle de l’articulation dans la lecture est immense. C’est l’articulation et l’articulation seule qui donne la clarté, l’énergie, la passion, la véhémence. Telle est sa puissance qu’elle peut racheter même la faiblesse de la voix, et même en face d’un grand auditoire. Il y a eu des acteurs de premier ordre qui n’avaient presque pas de voix. Potier n’avait pas de voix. Monvel, le fameux Monvel, n’avait pas de voix, il n’avait même pas de dents ! Et cependant, non seulement on ne perdait pas une de ses paroles, mais jamais artiste ne fut plus pathétique et plus entraînant. Comment ? Grâce à l’articulation. Le plus admirable lecteur que j’aie connu était M. Andrieux. Sa voix était pourtant plus que faible, elle était éteinte, éraillée, rauque…. Comment triomphait-il de tant de défauts ? Par l’articulation ! … On a dit de lui qu’il se faisait entendre à force de se faire écouter ; ajoutez : à force d’articuler.
Quelquefois, un heureux enrouement apprend à un acteur toutes les ressources de l’articulation. Un jour M. Bouffé répétait un des rôles qui lui ont fait le plus d’honneur, le père Grandet, dans la Fille de l’Avare. Arrivé à la scène la plus émouvante de la pièce, quand le vieil avare s’aperçoit qu’il est volé, l’acteur commence à crier comme à son ordinaire… Mais, au bout de quelques minutes, le son s’éteint sur ses lèvres ! … et le voilà forcé de répéter à voix basse ! Qu’arriva-t-il ? Qu’il fut mille fois plus vrai et plus touchant, parce qu’il fut forcé de suppléer à la faiblesse du son par l’articulation. On ne peut pas parler sans voix, mais la voix seule est si insuffisante dans la diction qu’il y a des lecteurs, des orateurs et des acteurs pour qui la richesse même de leur organe vocal est un inconvénient. S’ils ne savent pas articuler, le son mange le mot ; les voyelles mangent les consonnes ; ils parlent si haut, ils lisent si haut, ils font tant de bruit en lisant et en parlant, qu’on ne les entend pas. Parfois, même, la mode supprime l’articulation. Vous vous rappelez que, dans le siècle dernier, les élégants disaient : ma paole d’honneur ; c’était du pédantisme que de prononcer les consonnes. Un vieil habitué du Théâtre-Français disait avoir vu, en soixante ans, changer trois fois la manière d’articuler, dans ce qu’on appelle la jeunesse dorée. Pour les hommes sérieux, il n’y en a qu’une, c’est de prononcer assez pour être entendu, pas assez pour être remarqué.
CHAPITRE VI
ZÉZAIEMENT ET GRASSEYEMENT
Il y a, outre ces défauts généraux, des vices particuliers de prononciation. On peut les réduire à trois : le zézaiement, le grasseyement et le bégayement. Zézayer ou bléser, c’est prononcer les s comme des z ; c’est, par mauvaise habitude ou par défaut de conformation, permettre à la langue de dépasser les dents quand on prononce l’s. L’inconvénient de ce défaut, c’est de donner à celui qui en est atteint un air de niaiserie. En voici une preuve curieuse : M. Régnier était jeune, il fut chargé d’un rôle de niais, il ne savait comment exprimer ce caractère ; le hasard le conduit chez un marchand où se trouvait un acheteur qui blésait ; les commis eux-mêmes souriaient en l’écoutant . « Je tiens mon rôle, se dit M. Régnier : cet homme a l’air d’un imbécile, je n’ai qu’à l’imiter. » Vous voyez que ce défaut vaut qu’on le corrige. Le moyen est facile. S’exercer longtemps, continûment, à prononcer les s, en appuyant fortement le bout de la langue sur la partie intérieure des dents de devant ; cette gymnastique habitue la langue à ne plus sortir de l’enceinte fortifiée, et l’habitude corrige le défaut.
Grasseyer, c’est prononcer la lettre r avec la base de la langue, avec la gorge. Ne pas grasseyer, c’est prononcer la lettre r avec le bout de la langue, en frappant d’un coup sec le commencement du palais, tout près des dents. Prononcer la lettre r sans grasseyement, c’est la faire rouler, c’est la faire vibrer. On dit en langage de théâtre de quelqu’un qui ne grasseye pas, il vibre. Le grasseyement est un défaut très commun. Presque tous les Parisiens grasseyent. Le Marseillais est le modèle du grasseyeur. En général, pourtant, les peuples du Midi ne grasseyent pas. L’inconvénient de ce défaut est d’alourdir la prononciation et de vous interdire le chant italien. Les oreilles italiennes ne peuvent supporter ce défaut. Un célèbre artiste de l’Opéra, M. Alizard, qui possédait une des plus belles voix de basse que j’aie entendues, se voyait obligé de refuser un superbe engagement en Italie, parce qu’il grasseyait. Grand désespoir pour lui ! Un acteur célèbre le consola en le corrigeant comme il s’était corrigé lui-même. De quelle façon ? Par un moyen qui vient de Talma. Il y a deux lettres que tout le monde prononce toujours et naturellement du bout de la langue, c’est le t et le d. Eh bien, Talma, qui grasseyait, imagina l’exercice suivant : prononcer vivement et alternativement ces deux lettres t et d, puis peu à peu leur adjoindre la lettre r… c’est-à-dire la tirer pour ainsi dire du fond du gosier, où elle s’enfouit ; la forcer de répondre à l’appel de ses deux compagnes, d’entrer, si j’ose ainsi parler, en danse avec elles. Figurez-vous une jeune fille… pardonnez-moi cette comparaison singulière, … figurez-vous une jeune fille qui se cache au bal dans un coin, que deux de ses amies appellent et qu’elles entraînent dans leur ronde ; mais bientôt… une des deux danseuses s’éclipse, puis l’autre, et voilà la dernière venue forcée de danser seule. Ainsi faisait Talma. Il abandonnait d’abord la lettre d… puis la lettre t… et, de cette façon, la lettre r…, après avoir vibré avec les autres, vibrait toute seule.
Un célèbre acteur m’a conté la façon singulière dont il s’est corrigé du grasseyement. Il était jeune, il avait du talent, et il poursuivait à la fois deux entreprises inégalement chères pour lui, mais également difficiles : il travaillait tout ensemble à conquérir l’r roulant, et la main d’une jeune fille dont il était éperdument épris. Six mois d’efforts ne lui avaient pas plus réussi d’un côté que de l’autre. L’r s’obstinait à rester dans la gorge, et la demoiselle à rester demoiselle. Enfin, un jour, ou plutôt un soir, après une heure de supplications et de protestations de tendresse… il touche le cœur rebelle… la demoiselle dit oui ! … Ivre de joie, il descend l’escalier quatre à quatre, et, en passant devant la loge du concierge, il lui lance un sonore et triomphant : « Cordon, s’il vous plaît ! » O surprise ! … I’r de cordon a sonné vibrant et pur comme un r italien !… La peur le prend… Peut-être est-ce un heureux hasard ? Il recommence ! Même succès ! Il n’en peut plus douter ! L’r roulant est à lui ! Et à qui le doit-il ? A celle qu’il adore ! C’est l’ivresse de la passion heureuse qui a fait ce miracle ! Et le voilà qui s’en retourne chez lui, en répétant tout le long de la route, car il avait toujours peur de perdre sa conquête : Cordon ! S’il vous plaît ! Cordon ! S’il vous plaît ! Cordon ! S’il vous plaît ! Tout à coup, nouvel incident ! Au détour d’une rue sort de dessous ses pieds, sort d’un égoût, un énorme rat ! Un rat ? Encore un r ! Il l’adjoint à l’autre, il les mêle ensemble ! Il les crie ensemble ! Un rat ! Cordon ! Cordon ! Un gros rat ! Cordon ! Un gros rat ! Un gros rat ! Et les r roulent, et la rue en retentit ! Et il rentre chez lui triomphant ! Il avait vaincu les deux rebelles. Il était aimé et il vibrait ! Intitulons ce chapitre : De l’influence de l’amour sur l’articulation.
CHAPITRE VII
LE BÉGAYEMENT
Le bégayement constitue un vice plus grave, plus rebelle et d’une espèce fort particulière. C’est un défaut à la fois matériel et intellectuel. Il tient sans doute à la conformation, et, alors, il ressort de la médecine, mais il tient aussi de l’intelligence, et il rentre alors dans l’art de la lecture. Souvent la langue bégaye, et bégaye habituellement, parce que l’esprit bégaye, parce que le caractère bégaye, parce qu’on ne sait nettement ni ce qu’on veut dire ni ce qu’on veut, parce qu’on est craintif, parce qu’on est colère, parce qu’on veut parler trop vite : impatience, timidité, manque de précision dans les idées, voilà les causes de cette sorte de bégayement qui n’est pas sans remède ; habituez-vous à parler lentement, à ne parler que quand vous êtes maître de vous, et vous cesserez de bégayer. Un chanteur distingué que je pourrais nommer bégaye légèrement quand il parle, et ne bégaye pas du tout quand il chante…. Pourquoi ? Parce que, quand il chante, il marche sur un terrain où il est sûr de lui-même. L’exercice, le travail, l’habitude, l’ont rendu maître de sa voix et de sa diction dès que la parole est unie au chant ; mais aussitôt qu’il parle, la timidité naturelle de son caractère le rend à toutes ses incertitudes de prononciation. L’artiste tombe, l’homme reste, et le bégayeur reparaît.
Quant au bégayement matériel, qui dépend de l’organe seul, la médecine seule peut le guérir. Il porte en général sur toutes les lettres ; parfois, pourtant, le bégayeur a dans l’alphabet certains ennemis particuliers, c’est-à-dire des lettres devant lesquelles il s’arrête toujours, comme les chevaux devant certains obstacles. Je peux citer un fait curieux à ce sujet. J’ai écrit, il y a vingt ans, avec Scribe, une comédie où se trouvait un rôle de bègue : les Doigts de fée. Le personnage devait être comique, mais non ridicule, et, parfois même, je désirais qu’il fût touchant. M. Got avait accepté ce rôle avec plaisir, mais, dès qu’il en commença l’étude, son embarras devint très grand. Il ne s’agissait pas là de faire un pendant à M. Brid’oison, mais comment arriver à l’intérêt, à l’émotion, en restant toujours dans le comique ? Enfin, un jour, il arrive tout triomphant à la répétition. « Je tiens mon rôle ! me dit-il. Je vais faire porter le bégayement seulement sur deux consonnes, toujours les mêmes, le p et le d. Grâce à ce moyen, que m’ont suggéré mes études récentes sur les bègues, je me délivre de la préoccupation insupportable où m’aurait jeté la nécessité de bégayer toujours, je débarrasse le rôle de la monotonie d’un défaut répandu partout, et je ne garde de cette imperfection que juste ce qu’il en faut pour donner du piquant et du comique à ma diction. Seulement, ajouta-t-il gaiement, vous voilà un supplément de travail, mon cher auteur ; il faut enrichir mon rôle de quelques p et de quelques d de plus. Je vous indiquerai les passages où j’en aurai besoin. » Ainsi fut fait, et le succès répondit pleinement à son attente. Je ne crois pas que cet artiste si éminent compte de création plus originale.
Le bégayement organique est-il curable ? J’en doute. La médecine a fait beaucoup d’essais ; je n’ai pas vu de véritables réussites. Des atténuations passagères, des intermittences, des apparences de guérison… mais une guérison réelle ? Non. Certains spécialistes ont fait afficher dans les journaux le nombre de leurs cures merveilleuses. Voici un fait dont j’ai été le témoin. Je me trouvai un jour, dans ma jeunesse, à un bal donné par un médecin célèbre par cette spécialité, et qui a rendu de très grands services à l’art de la parole par ses travaux théoriques.
« Monsieur, dis-je à un de mes voisins, voulez-vous me faire vis-à-vis pour la contredanse ?
– Vo-o-olontiers, monsieur.
Ah ! un bègue ! » me dis-je.
On passe des rafraîchissements.
« Monsieur, dis-je à un autre jeune homme, voudriez-vous me passer une glace ?
V..v..v… oici !
– Ah ! un second bègue ! … »
Je me trouve en face d’un de mes anciens camarades de collège.
« Ah ! Ah ! c’est toi !… me dit-il. Te te… ra… ra… ra… rappelles-tu comme je bé… bé… bé… gayais au collège ? …
– Oui.
Eh bien… je suis venu… trouver M. Co… co… co… lombat (c’était notre amphitryon), et, depuis ce moment, je suis… tout à fait gué… gué… gué… ri ! »
Ce souvenir m’a toujours rendu un peu incrédule à l’endroit des bégayeurs qui ne bégayent plus.
Reste enfin, pour achever ce qui regarde la lecture comme art matériel, à nous occuper de la ponctuation.
CHAPITRE VIII
LA PONCTUATION
On ponctue avec les paroles, comme on ponctue avec la plume.
Un jour M. Samson voit arriver chez lui comme élève un jeune homme assez satisfait de lui- même.
« Vous désirez prendre des leçons de lecture, monsieur ?
– Oui, monsieur.
– Vous êtes-vous déjà exercé à lire tout haut ?
– Oui, monsieur, j’ai récité beaucoup de scènes de Corneille et de Molière.
– Devant tout le monde ?
– Oui, monsieur.
– Avec succès ?
– Oui, monsieur.
– Veuillez prendre dans ce volume de la Fontaine la fable : le Chêne et le Roseau. » L’élève commença :
Le chêne un jour, dit au roseau….
– Très bien ! Monsieur, vous ne savez pas lire !
– Je le crois, monsieur, reprit l’élève un peu piqué, puisque je viens réclamer vos conseils, mais je ne comprends pas comment sur un seul vers…
– Veuillez le recommencer. »
Il recommença.
Le chêne un jour, dit au roseau….
– J’avais bien vu que vous ne saviez pas lire.
– Mais…
– Mais, reprit M. Samson avec flegme, est-ce que l’adverbe se joint au substantif au lieu de se joindre au verbe ? Est-ce qu’il y a des chênes qui s’appellent un jour ? Non ; eh bien, alors, pourquoi lisez-vous : le chêne un jour, dit au roseau… lisez donc : le chêne, virgule, un jour, dit au roseau.
– C’est pourtant vrai ! s’écria le jeune homme stupéfait.
– Si vrai, reprit son maître avec la même tranquillité, que je viens de vous apprendre une des règles les plus importantes de la lecture à haute voix, l’art de la ponctuation.
– Comment, monsieur, on ponctue en lisant !
– Eh ! sans doute ! Tel silence indique un point ; tel demi-silence, une virgule ; tel accent, un point d’interrogation ; et une partie de la clarté, de l’intérêt même du récit, dépend de cette habile distribution des virgules et des points, que le lecteur indique sans les nommer, et que l’auditeur entend sans qu’on les lui nomme. »
La ponctuation écrite variant à chaque siècle, la ponctuation parlée doit varier de même. Supposez qu’un poète tragique trouvât aujourd’hui le : « Qu’il mourût ! » de Corneille… il mettrait au bout un immense point d’exclamation, et peut-être deux. Qu’a mis Corneille ? Une virgule. Cette virgule en dit beaucoup. Elle indique que, dans l’esprit de Corneille, ce mot n’était nullement un mot à grand fracas, mais un cri involontaire, à l’instant corrigé par le second vers, que Voltaire trouve faible, parce qu’il n’en a pas senti la délicatesse exquise ! C’est le Romain qui s’écrie : Qu’il mourût ! C’est le père qui ajoute : « Ou qu’un beau désespoir alors le secourût ! »
Les petits points sont d’invention moderne. Vous n’en trouverez pas un seul exemple dans le dix-septième siècle ni dans le dix-huitième. Ils s’emploient surtout dans les œuvres dramatiques. Scribe est un des grands inventeurs des petits points. Ils répondent à ce qu’il y a, dans l’action de ses pièces, de précipité, d’agité, de fiévreux ; c’est la ponctuation d’un homme que l’action presse, que le mouvement emporte, qui n’a pas le temps de tout dire ; c’est la ponctuation du sous-entendu. Ponctuer ainsi, en lisant, est d’une très grande difficulté.
On voit que j’ai dit vrai en disant que la lecture était un art, et que cet art avait des règles précises, puisque nous en avons trouvé pour l’émission de la voix, pour la respiration, pour la prononciation, pour l’articulation et pour la ponctuation, c’est-à-dire pour tout ce qui regarde la partie matérielle de l’art de la lecture, le mécanisme. Passons maintenant à la partie intellectuelle.
Transcription par l’équipe de Charlotte Mason France du Petit Traité de Lecture à Haute Voix d’Ernest Legouvé.